Un abécédaire critique
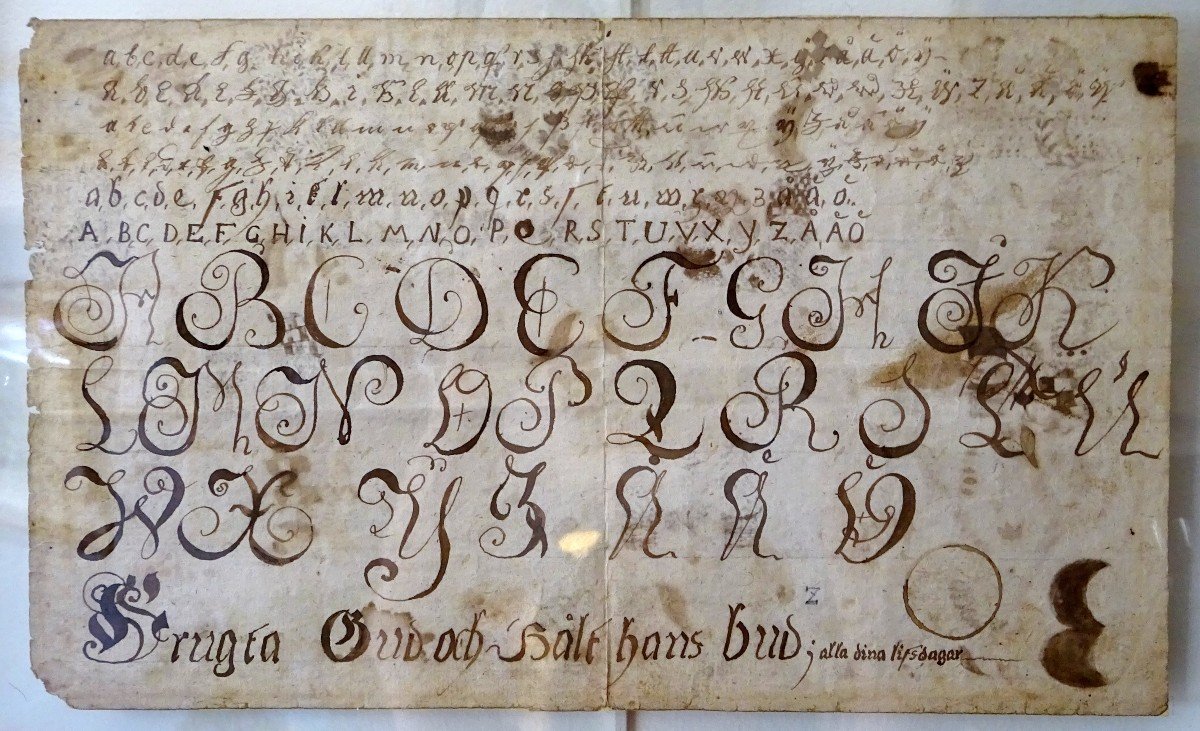
Les mots du langage médiatique et politique dominants ne sont pas neutres. Ils véhiculent, le plus souvent implicitement, une certaine vision monde. L'abécédaire ci-dessous tente de mettre en lumière les usages, et souvent le dévoiement sémantique, d'une trentaine de mots ou d'expressions. A contrario d'une pensée unique, laquelle prétend détenir la vérité et exclure toute critique, alternative ou utopie, nous proposons d'autres définitions afin de nourrir un débat trop souvent confisqué. Refusant toute domestication de la pensée, cet abécédaire offre un outil réflexif au service des espaces de dialogues, base de toute démocratie.
« Mais la fonction spéciale de certains mots novlangue comme ancipensée, n'était pas tellement d'exprimer des idées que d'en détruire. » Georges Orwell, 1984.
Lexique
- Agrivoltaïsme
- Anthropocène
- Clandestin
- Classe moyenne
- Communautarisme
- Conflit
- Dématérialisation
- Écosystème
- Égalité
- Égalité des chances (voir aussi « mérite », et «talent »)
- Énergie
- Extrême (en politique)
- Grogne (sociale)
- Hégémonie culturelle
- Marchandisation
- Mérite
- Migrant
- Neutralité carbone
- Normales saisonnières
- Passoire thermique
- Pédagogie
- Plein emploi
- Produit Intérieur Brut
- Responsable
- Subsidiarité (principe de)
- Talent
- Température ressentie
- Travail (valeur travail)
- Valorisation
- Violence
- ZNP (Zone Naturelle Photovoltaïque)
Agrivoltaïsme
Mot orwellien1.
« Système étagé qui associe une production d'électricité photovoltaïque et une production agricole au-dessous de cette même surface » (Wikipédia). Ce néologisme appartient à la catégorie sémantique des mots qui s'attaquent aux « anciens » schémas de pensées. Ce qu'il désigne, c'est le mariage sur un même terrain de l'agriculture avec l'industrie, d'où il s'ensuit que cette dernière est écologique, soluble dans le monde « paysan », qu'elle constitue des opportunités financières pour un secteur en difficulté… La diffusion de cette industrie tous azimuts en est la conséquence, l'extension maximale du marché de l'électricité la finalité. On notera que l'agrivoltaïsme ne rentre pas dans les statistiques officielles de l'artificialisation des sols...
[1] On ne peut qu'être saisi par les analogies entre certains néologismes administratifs actuels et la novlangue d'Orwell, en particulier en ce qui concerne la formation de mots composés et d'abréviations, cf. Georges Orwell, 1984, Gallimard 1950, pages 421 à 439.
Anthropocène
Terme désignant une époque géologique marquée principalement par l'action d'une humanité ayant bouleversé l'environnement et le climat. Si ce concept ouvre la porte à une critique remettant en cause la société technocratique et industrielle, on observe que le récit officiel de l'Anthropocène véhicule deux significations implicites contestables : d'une part les humains seraient tous responsables de ce désastre de manière indifférenciée (l'homme de Cro-Magnon au même titre qu'un capitaine d'industrie), et d'autre part la nature autonome, altérité à l'espèce humaine n'existerait plus, ce qui ouvre la porte à toutes sortes d'artificialisations, institutionnelles ou relevant de comportements individuels. Désormais, histoire de la terre et histoire humaine se confondent et leur avenir serait conditionné par un progrès technique sous contrôle capitaliste. Aussi le discours dominant de l'Anthropocène trahit-il un anthropocentrisme finalement classique : celui d'un système s'appuyant sur la science et œuvrant pour l'avènement d'un géopouvoir ivre de toute puissance.
Clandestin
"Clandestin", mot qu'on utilisait hier sans souci de ses connotations possibles, a acquis un sens péjoratif. Il peut être supplanté notamment par "migrant" pour désigner le même statut juridique. Curieux destin de ce mot qui, au temps de l'occupation nazie, fut revendiqué avec fierté et assimilé à une forme d'héroïsme, avant de retrouver sa connotation péjorative. Accolé au mot « immigration », il désigne aujourd'hui quelque chose de l'ordre du mal
absolu : la personne de nationalité étrangère et en situation irrégulière est qualifiée de « clandestin ». « Travailleur clandestin » ou « immigré clandestin », ces deux figures se superposent dans les représentations communes. La clandestinité n'est pas seulement condamnable parce qu'illégale ; elle fait peur, comme tout ce qui ne se montre pas au grand jour : la France serait menacée d'une invasion rampante. Or l'administration française fabrique elle même nombre de ces« clandestins » : si, en dépit de tant de lois sur l'immigration, autant d'étrangers se trouvent toujours en situation légalement irrégulière, c'est surtout parce que ces derniers permettent aux patrons de surexploiter une main-d'œuvre dépourvue de droits.
Classe moyenne
Objectif : « deux français sur trois » (Valéry Giscard d'Estaing, 1984). Vous n'êtes ni SDF, ni « assisté », ni « riches » ; vous vous « levez tôt pour travailler », sans pouvoir bénéficier de droits sociaux, tout en étant surimposé par le fisc : vous êtes majoritaires et vous devez alors vous sentir membre de la « classe moyenne ». Cette fiction, malheureusement assez efficace, tend à faire disparaître les classes populaires des représentations sociales. Or ces dernières réunissent près de la moitié de la population. Elle tend aussi à diviser celles-ci, entre leur fraction précarisée, en forte croissance, négligeable électoralement, et leur fraction (encore) stabilisée, sommée de se reconnaître dans la « classe moyenne » et de voter pour ceux qui prétendent la défendre.
Communautarisme
La « communauté » (pensée généralement en termes culturels ou religieux) serait un enfermement qui menace l'intégrité de la nation. Mobiliser ce terme revient alors à reprocher à des individus ou des groupes, supposés d'origine étrangère, de ne pas jouer le jeu de « l'intégration » et par-là d'être responsables des maux de la société. Or il faut rappeler que ce terme désigne en premier lieu une façon de concevoir la nation et la citoyenneté, qui diffère du modèle français. Ni bonne, ni mauvaise en soi, la conception de la nation dite « communautaire », « communautariste » ou « multiculturelle » renvoie à l'idée que les citoyens participent à la vie sociale en s'inscrivant dans des groupes d'affinités et d'appartenances, qui servent d'intermédiaires politiques avec l'État. Selon cette vision, les minorités sont reconnues comme des acteurs politiques et leurs droits culturels garantis. Et les appartenances pas sont alors pas exclusives, un même individu pouvant se reconnaître et s'investir dans plusieurs communautés. Le Royaume-Uni, les États-Unis, ou encore les Pays-Bas, reconnaissent ainsi la multiplicité des communautés et des appartenances comme un ressort de l'action politique et un gage de stabilité pour la nation. Or ces pays ne connaissent pas plus (ou pas moins) de problèmes que la société française. Aucun modèle n'est supérieur à un autre : ce sont des idéaux qui orientent l'organisation politique d'une société, mais ne la résument pas.
Conflit
« Conflit » n'est pas « guerre ». On nous parle pourtant plus souvent de « conflit » que de « guerre », entre l'Ukraine et la Russie, ou entre la Palestine et Israël. Or il s'agit bien de guerres car des humains en armes y sont engagés. Le conflit, le désaccord, le dissensus – entre personnes, groupes sociaux, idées – sont une forme fondamentale de toute vie sociale. Son organisation ou sa régulation sont une des bases de la démocratie. Par exemple lorsqu'on échange, qu'on argumente, lorsqu'on met en place des dispositifs pour délibérer, on pratique la démocratie. La confusion entre ces deux termes est très dangereuse, elle fait partie d'une évolution vers un régime autoritaire. Lorsque les adversaires politiques deviennent des ennemis irréconciliables ; lorsque les opposants sont criminalisés ; lorsque les arguments laissent place aux invectives et aux insultes, le débat démocratique disparaît et la démocratie avec.
Dématérialisation
Désigne en réalité une déshumanisation. Ce que les autorités (politiques, administratives...) nomment « dématérialisation » n'en est pas une. Au contraire, ce qu'ils désignent par ce terme, c'est une pratique brutale de fermeture de lieux d'accueil et de remplacement de fonctionnaires par des plates-formes informatiques. C'est-à-dire, comme le dit Nicolas Bérard, « remplacer des êtres humains par du matériel : ordinateurs, réseaux internet et sans fil, centres de stockage de données ». Ce n'est pas le matériel qui disparaît (au contraire, on le dissémine inconsidérément), ce sont les êtres humains. La (fausse) dématérialisation cache la (véritable) déshumanisation. Dérèglement climatique Fait partie des mots-confusion. Lors des discussions sur le réchauffement climatique, il est courant de se voir rétorquer : « Non, pas réchauffement climatique, dérèglement climatique!» Or, si dérèglement il y a, il constitue une des conséquences de l'augmentation de la température. Le mot dérèglement, abstrait, évacue la radicalité du processus en cours : celui d'un réchauffement continu et irréversible pour les décennies à venir. Terme vague, s'il inquiète, rien de très précis ne peut lui être associé. Le mot réchauffement est concret : il signifie une hausse implacable du thermomètre, hausse dont on ne voit pas le terme, alors que le seuil de 58 degrés Celsius est celui à partir duquel la vie humaine n'est plus possible. On notera que le gouvernement a choisi de parler de « dérèglement climatique » (cf. site du ministère concerné).
Écosystème
Association d'êtres vivants dans son unité biologique. Ce terme est issu des études naturalistes sur les interactions entre des êtres vivants dans leur milieu naturel. Aujourd'hui se répand l'usage de ce mot appliqué aux activités humaines structurées (tourisme, entreprises, etc.). Dès lors, on établit un rapport d'équivalence entre des milieux anthropiques et naturels. L'utilisation extensive de ce mot contribue à dissoudre l'idée de nature au profit du souci de l'humain, notamment dans sa forme entrepreneuriale. Or un écosystème « naturel » s'insère généralement dans un rapport antagoniste avec l'économie capitaliste.
Égalité
Valeur promue par la révolution Française, elle deviendra synonyme de nivellement par le bas, pour mieux ériger l'individu possessif égocentrique au rang d'un être supérieur fabriqué par lui-même. Cet individu ignore les raisons mêmes de son apparition sur terre que sont le hasard et la nécessité. Cette ignorance, lui permet de faire passer les différences interindividuelles (nécessaires à la vie et naturelle) comme une valeur qu'il aurait construite par sa seule volonté. Il croit, alors, en tirer un mérite et une supériorité lui permettant de ne plus considérer les humains comme des égaux, mais comme des rivaux. La compétition et la domination sont alors son seul horizon.
Égalité des chances (voir aussi « mérite », et «talent »)
Qu'elle soit vue comme déjà réalisée, ou, plus souvent, vue comme un idéal à atteindre, cette vision appauvrie de l'égalité n'interroge par les inégalités structurelles et les rapports de domination qui les fondent. Elle se différencie de l'objectif d'égalité des conditions. Elle naturalise ainsi l'ordre social hiérarchisé et s'illusionne sur la possibilité de corriger sa reproduction en « donnant un peu plus à ceux qui ont moins ». Cette vision nourrit de multiples politiques publiques depuis les années 1980, à commencer, dans le domaine scolaire, par les Zones d'Éducation Prioritaires. On en voit les limites, puisque toutes les inégalités continuent néanmoins de se creuser.
Énergie
Mot floutant la réalité industrielle. Ce vocable (qui évoque la puissance, le dynamisme, l'aptitude à agir, la force de la volonté etc.) possède une connotation très positive. En physique il s'agit de la capacité d'un corps ou d'un système à produire du travail mécanique (Lexilogos). Les industriels ont bien compris que son utilisation était en mesure de combattre les critiques que suscitait leur activité polluante. En 2021 Total est devenu TotalEnergies, et à Cadarache, nous trouvons la Cité des Énergies (créée en 2013), une excroissance du CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique, situé à proximité) axée sur la recherche en énergies bas-carbone. Dans ces deux cas, l'utilisation du mot « énergie » constitue un grossier écoblanchiment diluant les productions pétrolière et nucléaire dans le mix énergétique. On espère ainsi que l'imaginaire collectif accepte ce verdissement tout en ayant conscience que les populations ne sont pas entièrement dupes, et que prévaudra la puissance du mythe selon lequel aucun progrès humain n'est imaginable sans croissance des ressources énergétiques.
Extrême (en politique)
Une politique ou un parti politique sont qualifiés d'extrême lorsqu'ils ne respectent pas les « valeurs républicaines ». Par exemple lorsque l'on dénonce l'inégalité des droits effectifs en fonction de l'origine géographique. Ou bien lorsqu'on conteste les institutions. Ces dernières années, ce concept d'extrême, s'est élargi pour désigner également ceux qui remettent en question l'ordre économique dominant : seule l'économie de marché serait donc possible et raisonnable. Stigmatiser comme « extrême » tout point de vue critique sur l'ordre économique et social néolibéral vise à écarter toute discussion de fond sur un système économique pourtant pas incompatible avec le fonctionnement même de notre milieu de vie.
Grogne (sociale)
Contestation populaire qui, ainsi désignée, est dévaluée, voire méprisée, car animalisée : la grogne est le cri de certains animaux –comme le chien, le cochon, l'hippopotame, le lion, le loup, l'ours, l'otarie, le phoque, le porc, le rhinocéros ou le sanglier. Les animaux, ne sachant ni penser ni réfléchir ne revendiquent et ne proposent rien. Pourtant banalisée par les média dominants, cette expression péjorative, voire méprisante, disqualifie surtout les mouvements des classes populaires quand ils sont sectoriels et corporatifs. Ils n'osent pas l'utiliser quand ils sont trop massifs – comme l'est actuellement le mouvement sur les retraites – ou pour d'autres mouvements sociaux plus consensuels – comme les luttes féministes – ou émanant de professions choyées par la droite (agriculteurs, médecins…).
Hégémonie culturelle
Concept développé par Antonio Gramsci (1891-1937), dirigeant du parti communiste italien et philosophe marxiste. Tirant les enseignements de l'échec de l'extension de la révolution russe au continent européen aux lendemains de la première Guerre mondiale, il remet en question la vision déterministe et économiciste d'un passage du capitalisme en socialisme qui résulterait du développement des « forces productives » et de l'accroissement du prolétariat. La classe bourgeoise dispose en effet d'une série de ressources idéologiques et culturelles non seulement dans les institutions politiques – gouvernement, police, justice… – mais dans tout le tissu de la société civile. Ce n'est que par un patient travail idéologique et culturel alternatif de conquête des esprits que les forces de transformations sociales peuvent espérer établir leur hégémonie culturelle et dépasser le capitalisme.
Marchandisation
Processus tendant à transformer en marchandise des biens et des services qui avaient échappé à la logique marchande au fil des progrès d'un « État social ». Il a pour conséquence de remettre en questions une série de liens sociaux reposant sur la solidarité et la gratuité. Exemples : le service désormais monnayable de la visite du facteur chez une personne âgée ; se faire remplacer dans une file d'attente en rémunérant une autre personne ; rendre service à un voisin (cf. le site internet : https://www.allovoisins.com/).
Mérite
« Instrument de gouvernement destiné à renforcer l'obéissance à l'ordre social par un système de valorisation ou de réprobation des comportements » (Chantal Jaquet). Les individus héritent de certains dons, qu'ils convertissent en talent(s), au prix de certains efforts. En résulte un mérite qui est ou devrait être reconnu par leur réussite sociale, leur place dans l'ordre social. En bas, les non-méritants. En haut les méritants. Tous responsables de leur sort. Les premiers, résignés et culpabilisés. Les seconds, certains de la légitimité de leurs privilèges. Initialement progressiste, car opposée à la transmission héréditaire des inégalités sociales, la visée d'une égalité des chances fondée sur le mérite est mise au service de la conservation de l'ordre social quand elle renonce à remettre en question cet ordre social, et à interroger les conditions sociales de son effectivité ; qu'elle renonce donc à viser une égalité des conditions, associée au libre développement des capacités de toutes et tous.
Migrant
Hier « immigré », ou même « travailleur immigré », le migrant n'est plus qu'un être en transit. On ne sait d'où il vient ni où il va. C'est qu'on ne souhaite pas le savoir. Sans attache territoriale, passée ou future, il est nécessairement « clandestin » et menaçant. Donc sans droit et expulsable. Il n'y a pas de « migrants », mais des « exilés », des « réfugiés », et des « sans-papiers » à accueillir dans le cadre de l'impératif humain universel d'hospitalité, et auxquels proposer une place sociale digne sur notre sol.
Neutralité carbone
Objectif intégré dans les plans gouvernementaux de divers pays dont la France (« Plan Climat ») ou faisant l'objet de communications de la part de grandes entreprises. Il désigne un équilibre entre les émissions anthropiques et celles pouvant être absorbées naturellement (voire artificiellement dans le futur). Exemples : l'achat de forêts en vue de leur protection ou l'investissement dans un parc éolien génèrent des certificats de CO2 qui autorisent les grandes entreprises à se soustraire à l'impératif de réduction des Gaz à Effet de Serre (GES). La neutralité carbone n'implique donc aucunement une réduction des émissions. Cette aberration voudrait que la caresse légitime la gifle. De plus, les forêts mondiales étant saturées en carbone, la "captation" invoquée est parfaitement théorique. Pour le capitalisme mondialisé, il s'agit avant tout de perdurer. Afficher l'objectif de la « neutralité carbone » lui permet de poursuivre la croissance des émissions de GES et d'éviter sa remise en question.
Normales saisonnières
Fait partie désormais des mots-confusion. Une « normale » est ce qui correspond à une norme, à ce qui est dépourvu de tout caractère exceptionnel. Les normales saisonnières sont fixées par Météo France qui se base sur la moyenne des mesures effectuées pendant une durée de 30 années consécutives. Depuis juin 2022, cette référence s'est modifiée et de nouvelles « normales » sont apparues, mettant en lumière une hausse due au réchauffement climatique. Dorénavant, les « normales saisonnières » ont donc pour fondement une anormalité. Cette situation est parfaitement décrite par Météo France qui annonce : « Ces nouvelles « normales » sont cependant loin de décrire notre climat normal d'il y a encore quelques décennies. » L'usage courant de cette formulation dans les médias a donc pour effet de minimiser la réalité du réchauffement climatique en faisant apparaître comme « normales » des données qui ne le sont pas.
Passoire thermique
Locution officielle désignant des logements « énergivores consommant une grande quantité d'énergie en raison de leur faible capacité d'isolation ». L'objectif est de pousser les propriétaires à effectuer des travaux d'isolation afin de contribuer à la neutralité carbone de la France en 2050. L'isolation thermique des bâtiments est une nécessité. Mais sa mise en œuvre institutionnelle est très discutable. Elle permet une emprise croissante du pouvoir sur la vie privée par le biais d'une stigmatisation des propriétaires qui n'ont pas les moyens, même avec les aides publiques, de réaliser des travaux d'isolation. Au-delà, elle vise implicitement tous les « mauvais citoyens » qui ne se plieraient pas à l'injonction. On valorise au passage un pouvoir qui ne ménagerait pas ses efforts pour réduire les émissions de GES, tout en offrant des débouchés à de nouveaux marchés...
Pédagogie
Méthode visant à obtenir le consentement de la population aux « réformes » qu'elle refuse, en expliquant et en répétant quelles sont de leur intérêt. Les décideurs étant les seuls experts légitimes, c'est à eux qu'il appartient, en mettant en œuvre cette pédagogie, de faire comprendre aux citoyens ignorants et/ou bornés le bien fondé de leurs choix politiques. Choix qui n'en sont pas puisqu'il n'en n'est pas d'autres possibles (There Is No Alternative : TINA). La pédagogie est donc la négation de la politique.
Plein emploi
Objectif en vue… dès lors que, comme dans les régimes économiques les plus libéraux, les droits sociaux de celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent accéder aux emplois disponibles mais de qualité médiocre – car très pénibles et/ou très mal rémunérés– sont réduits à leur plus simple expression. Le plein emploi keynesien de l'époque des « 30 Glorieuses » était déjà fort discutable – nombre de femmes se consacraient au travail domestique et ne se présentaient pas sur le « marché de l'emploi » – mais être en emploi c'était très largement l'être à temps plein en bénéficiant de protections sociales. Le plein emploi visé aujourd'hui est une supercherie : il s'agit d'un plein emploi précaire.
Produit Intérieur Brut
Depuis les années 50 le produit intérieur brut est devenu l'indicateur de référence pour nos économies. Or il exclut un certain nombre d'activités de son périmètre. Dès les années 30, son concepteur, Simon Kuznets, déclare que le bien-être d'une nation ne peut être déduit d'une mesure du revenu national. Les activités bénévoles (En France, 20 millions de personnes appartiennent à des associations), par exemple sont exclues du PIB. Pourtant, sans elles, l'activité d'un pays serait paralysée. La valeur ajoutée de la santé ou de l'éducation non plus n'est pas prise en compte. Que signifie une croissante du PIB dans ce contexte ? C'est donc un indicateur qui est sourd à la souffrance sociale, muet sur l'état de la planète, et aveugle au bien-être humain.
Responsable
Être responsable, c'est être sérieux, réfléchi, sachant peser le pour et le contre. C'est aussi être chargé d'un objectif à atteindre, d'une mission, d'une tâche, et de rendre compte du résultat. Aujourd'hui, si le Système communique sur l'éco-responsabilité de ses orientations et l'éthique environnementale des entreprises, il invoque fréquemment la responsabilité du citoyen face à l'écologie ou la sécurité. On en appelle à la conscience civique afin que chacun s'approprie les solutions qui nous guériront des maux actuels. La Sécurité routière clame : « tous responsables ! », et nous sommes sommés de devenir « éco-responsables » pour qu'advienne un futur vivable. En se focalisant sur l'individu, on dédouane le Système de son immense responsabilité. Ce ne sont pas les citoyens qui ont créé les infernales et dangereuses conditions de circulation, ni qui soutiennent financièrement le secteur de l'aviation civile, pour ne prendre que deux exemples. Ainsi, chacun a tendance à détourner son regard vers la « responsabilité » du voisin en oubliant de le porter sur celle des politiques qui sont à la racine des problèmes.
Subsidiarité (principe de)
Principe qui consiste à laisser les affaires publiques se régler localement autant que cela est possible. Il prend origine dans le droit canonique établi au 19ème siècle. Depuis le traité de Maastricht (1992) il est intégré dans le droit européen. On identifie couramment ce principe avec celui, démocratique, de la décentralisation. Cela peut être le cas. Mais dans la mesure où la doctrine néolibérale conçoit chaque entité — jusqu'à l'individu lui-même — comme responsable d'elle-même au sein du marché, ce n'est pas le cas général. De surcroît, l'expérience montre que ce principe est à géométrie variable, aussi bien dans le domaine politique qu'économique.
Talent
Vu principalement comme hérité par l'individu — proche en cela de la notion de don — au mieux comme cultivé par les efforts consentis, il fonde le mérite et justifie par là même les privilèges auxquels il donne, ou devrait donner accès.
Température ressentie
Température réelle à laquelle on associe un « indice éolien » : à température égale, s'il y a du vent on a davantage froid par déperdition de chaleur. Cette donnée peut avoir son importance en Alaska ou au Canada. Mais sous nos climats encore tempérés elle apparaît dérisoire et non rationnelle : la sensation de froid diffère selon les personnes, leur état physique, et les vêtements qu'ils portent. Mais la communication de cette donnée se substituant à l'objectivité du thermomètre déresponsabilise, infantilise et semble nous dire : « Couvrez-vous les enfants, il y a du vent alors il fait froid. » Le sensible n'est donc plus le vecteur de l'appréhension du réel qui, désormais, doit passer par l'interface de la technologie et d'une « rationalité ». De plus, en annonçant des températures plus froides que ce qu'indique le thermomètre (bien des gens ne feront pas la différence), cette notion a pour effet de minimiser dans l'imaginaire les effets du réchauffement climatique.
Travail (valeur travail)
Exercer une activité professionnelle sous la forme d'un emploi — même de qualité si médiocre qu'il vous enferme dans la condition de travailleur ou travailleuse pauvre — vaut mieux que la condition d'« assisté⋅e ». C'est-à-dire de bénéficier d'un minimum de droits sociaux ou d'aides sociales permettant à peine de survivre. Acceptez de « vous lever tôt » pour être exploité.e, vous échapperez aux vices associés à l'oisiveté. La valeur du travail (salarié) varie aux yeux du travailleur ou de la travailleuse. Elle peut être élevée s'il est correctement rémunéré, permet de vivre dignement (valeur extrinsèque) ; et plus encore s'il permet d'avoir prise sur son activité, s'il est en cohérence éthique avec ses propres valeurs, et s'il est doté d'une utilité sociale et écologique (valeur intrinsèque).
Valorisation
« Mise en valeur de quelque chose pour en tirer davantage de ressources » (cnrtl>2). Aujourd'hui, on parle de valorisation de son capital (y compris santé), de l'industrie, des territoires, d'une forêt, etc. Au premier abord, on ressent positivement la "valorisation" qui, de ce fait, devient une valeur (valorisation en tant que valeur). Celle-ci se cristallise en évidence, un principe non questionné, qui s'inscrit au cœur des modalités néolibérales. La valorisation, débarrassée de son voile, devient alors un principe concurrentiel qui jette tout un chacun dans une quête effrénée de performance : les déchets valorisés deviennent un marché, notre capital se doit de fructifier sous peine d'être étouffé par celui des autres, nous devons optimiser notre santé afin d'être performant (ce qui permet de conserver son emploi), les territoires ont l'obligation d'acquérir une valeur touristique, donc marchande, l'innovation-valeur est une opportunité... La "valorisation" devient ainsi injonction de la Concurrence au détriment de la Solidarité.
[2] Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales.
Violence
Toute dégradation, même légère et réversible – tag, voire peinture lavable – d'un bien public ou privé est désormais qualifiée comme telle. Et ses auteur.e.s sont susceptibles d'être appelé.e.s (éco) terroristes. La confusion entre les divers types de violence, est délibérément entretenue par les dominants pour masquer leur propre violence. Et d'abord celle qui est la « mère de toutes les autres ». Comme l'a dit si bien Dom Helder Camara>3 : « Il y a trois sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'êtres humains dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première, qui la fait naître, et la troisième qui la tue. »
[3] Dom Helder Camara (1909-1999), archevêque brésilien qui fit de la lutte contre la pauvreté son combat quotidien dans le Brésil de la dictature militaire. Qui a aussi déclaré : « Je nourris un pauvre et l'on me dit que je suis un saint. Je demande pourquoi le pauvre n'a pas de quoi se nourrir et l'on me traite de communiste. »
ZNP (Zone Naturelle Photovoltaïque)
Mot orwellien.
Association de deux adjectifs contradictoires au substantif « zone ». On rencontre cet oxymore orwellien dans de nombreux PLU (plan local d'urbanisme) de communes porteuses de projets industriels rémunérateurs. Comme pour l'agrivoltaïsme, on sème le flou en mélangeant impudiquement deux notions totalement opposées : la nature et l'industrie. L'idée de nature est ainsi fortement attaquée par les mots pour la raison qu'elle fait obstacle à la conquête du système politico-industriel. La conséquence en est le déboisement d'hectares et une artificialisation toujours plus grande des territoires. La finalité ? Le Marché.
